Vache folle: une "panique" politique. Par Robert Redeker.
Cet article est paru dans Libération le 23 janvier 2001 sous le titre Un terrorisme sans terrorisme.
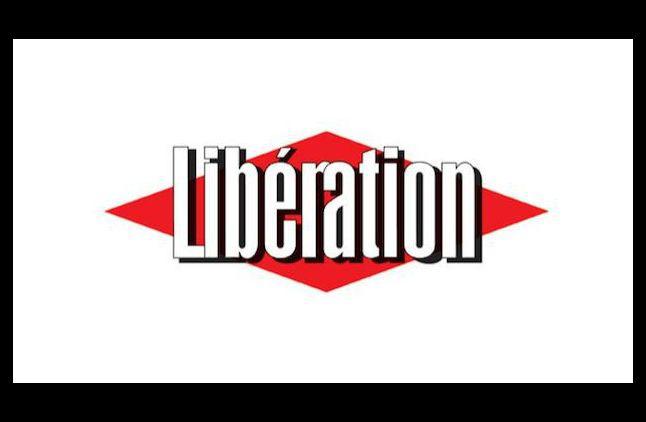
Vache folle: une "panique" politique. Par Robert Redeker.
Cet article est paru dans Libération le 23 janvier 2001 sous le titre Un terrorisme sans terrorisme.
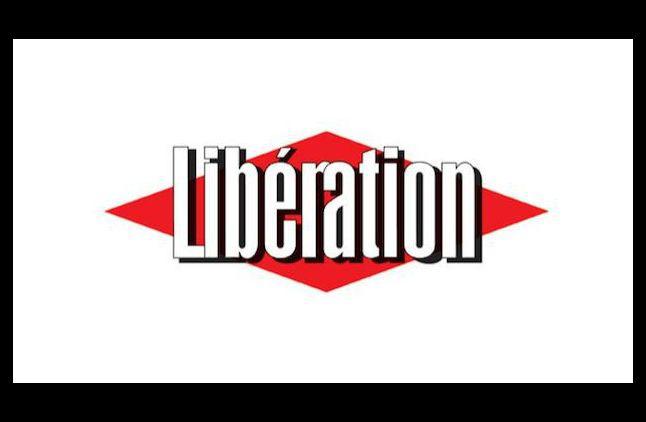
Vache folle ” : une panique politique.
Se souvient-on de la grande moisson organisée aux Champs-Elysées, le 24 juin 1990, par des syndicats d’agriculteurs ? Ce fut, selon un journaliste, une “ moisson urbaine et délocalisée, moisson de la performance technique ”? Moisson hors-sol, hors-nature, hors-paysage paysan, blé poussant sur le pavé et sur le bitume, agriculture hypertechnique au coeur de la mégapole! Sur un mode joyeux et festif cette grande moisson maccadamisée, célébrait des noces, sous la bénédiction du rationnel, entre l’agriculture, la techno-science et l’économie, noces qui sont aussi à l’origine de la “ maladie de la vache folle ”. La joie de cette fête ne masquait-elle pas l’amertume sans larmes d’un enterrement, celui de la paysannerie? Ou plutôt: d’un enbitumement de la paysannerie -inhumée en bloc sous le bitume, sous l’hypermodernité technologique, sous l’hyperhystérie économique! La grande moisson des Champs-Elysées n’annonçait-elle pas, à sa manière, son propre revers, “ la vache folle ”?
La vache folle n’est pas Fantômas. La mythologie populaire du savant fou divaguait sur la figure para-littéraire autant que para-scientifique d’un terroriste scientifique identifiable, aux prises avec son appétit de domination, se servant de la science en ayant conservé l’état d’esprit de la magie noire. Bien qu’invisible, pour des raisons stratégiques, ce terroriste - à l’instar de tous les terroristes de style classique - cherchait l’éclatante manifesteté: d’un côté il était marqué par la société, en recevait par la peur et la fascination une estampille d’infamie, tandis que de l’autre il signait, par sa perfidie ou par son idéal, ses méfaits. Par le truchement de cette double sémiologie, signature en aller-retour, être signé et signer, par cette parodie de contrat réciproque entre lui et la société, le terroriste inscrivait sa puissante visibilité dans le champ social. A l’opposé, la contemporaine “ affaire de la vache folle ”, pareillement à celle de Tchernobyl et de l’épidémie du SIDA, exprime notre entrée dans l’ère du terrorisme sans terroriste: une crainte diffuse, sournoise, indéchiffrable, s’insinue en chacun de nous, s’infiltre dans notre intimité, modifie insensiblement nos comportements, vient se lover dans le creux de nos poitrines. Une crainte qui atteint les fonctions biologiques : la respiration (Tchernobyl), la sexualité (le SIDA), la nourriture (la vache folle). Tchernobyl, “ la vache folle ”: le terroriste à l’inverse de ce qu’on a connu jusqu’à aujourd’hui est désormais le système économico-scientifique (l’éco-techno-science) dans son entier, invisible et gigantesque appareillage anonyme que plus personne ne pilote.
Aristote nous suggère qu’il convient de voir dans la nutrition le fondement matériel de la vie dans sa plus grande extension, sa condition: “ c’est donc en vertu de ce principe nutritif que tous les êtres vivants possèdent la vie ”. Il en résulte que le soupçon qui s’est insinué en chacun d’entre nous quant à une contamination invisible de la chère perturbe le rapport que nous entretenons avec le sol de notre activité organique, vitale, la nutrition. La nutrition est cette activité organique qui relie un être vivant à la nature; sans ce rapport de nutrition, un tel être pourrait être envisagé comme une entité autonome, un robot (ce qui distingue avant tout les robots des êtres vivants, c’est que les robots ne mangent pas). Avant même la communication sexuelle, la nutrition se présente comme la communication fondamentale, l’échange permanent, perpétuel, entre chacun des êtres vivants et la nature dans son ensemble. Ainsi, l’affaire de la vache folle, par la faute de la suspicion qu’elle laisse planer sur ce que nous mangeons, de la terreur indéterminée qu’elle génère, trouble au même titre, notre rapport à l’activité organique la plus élémentaire, celle que nous partageons avec tous les autres êtres vivants, et notre relation au reste de la nature.
La nutrition est cette fonction qui articule la nature avec la politique : elle est la charnière entre la communication avec la nature et la communication avec la société. Outre cette immédiate communication avec la nature, la nutrition implique de surcroît, chez l’homme, un acte de foi dans la culture, dans la première de toutes les cultures, celle qui conditionne toutes les autres, toutes les formes de la vie collective des hommes, l’agri-culture. La nutrition porte témoignage de la confiance de chacun dans la civilisation. Aussi doit-on mettre la nutrition en parallèle avec le sommeil (la sagesse populaire énonce avec une grande profondeur le lien entre la paix du sommeil et la paix du repas: “ qui dort dîne ”) qui à son tour exige cette confiance: pas plus que la paix de la nuit - obscurité périlleuse vouée chez les animaux aux alarmes et aux alertes, aux chassants et aux chassés, noirceur tragique propice aux prédateurs et aux proies -, produit de la civilisation, la confiance dans la nourriture n’est naturelle. Le manger en paix et le dormir en paix sont autant des conquêtes culturelles de l’homme que des faits politiques : les bêtes n’ont pas d’autre solution que de vivre sans cesse aux aguets, sans trêve ni repos, menacées de se faire dévorer pendant leur sommeil, délogées si elles s’oublient, contraintes de se tenir sur le qui-vive pendant même qu’elles se nourrissent. Les deux, dormir et manger humainement, présupposent la confiance dans la sécurité qu’apporte la civilisation. L’insécurité du dormir et du manger déshumanise, bestialise. La méfiance quant à la nourriture introduite par cette affaire de “ la vache folle ” -de même que le serait, si elle devait survenir, la méfiance quant à la sécurité du sommeil- fissure le socle anthropologique de la civilisation, lacère le fondement de la politique, brouillant la distinction entre l’homme et les autres animaux, nous rapprochant dangereusement de la frontière qui partage la culture de la barbarie.
La confiance dans ce que l’on mange structure (avec quelques autres confiances) le socle de la vie collective - et il n’y pas d’autre vie humaine que collective! La terrifiante singularité de “ l’affaire de la vache folle ” est mise en pleine lumière dès lors que l’on conçoit que ce sont les deux concepts qui constituent philosophiquement l’homme, celui de “ nature ” et celui de “ culture ” (physis/polis) qui s’y trouvent impliqués: voici le rapport organique de l’homme à la nature perturbé tout autant que l’est le rapport de l’homme à la société.
La perte de confiance dans la nourriture, ce lieu où s’épousent nature et politique, engendre la première panique collective du XXIème siècle. Se propageant telle une épidémie, elle couvre d’une ombre millénariste ce début d’hiver 2000-2001. Différente de la peur - qui est susceptible d’être positive au point de pouvoir se trouver à la source du principe de responsabilité - la panique n’est qu’atrocement destructrice: destructrice pour le lien social, qu’elle détresse, ravageuse, destructrice pour le sujet individuel, déchiré en lambeaux après un accès de panique. La panique est tout à fait analogue à un cyclone, mais dans l’ordre de l’humain. : elle fissure le lien qui attache chacun avec la société. La techno-agriculture ultraproductiviste, à la fête lors de la moisson des Champs Elysées, dont l’utopie est la source de l’affaire de la vache folle, s’achève dix ans après en cauchemar : désastre pour la santé publique, la panique insidieuse devant le terroriste aussi invisible qu’imaginairement omniprésent que constitue la maladie de Creutzfeld-Jacob, est également une catastrophe dans l’ordre politique, un désastre pour la santé politique.
Robert Redeker